on découvre un jour que la grippe s’agrippe

On a beau se couvrir, se réchauffer :
on découvre un jour que la grippe s’agrippe
par Varuna Singh
Cadeau empoisonné des mois des mois d’hiver, souvent bénigne, parfois terrassante, la grippe frappe indifféremment dans les deux hémisphères. Difficile d’y échapper à moins de mener une vie aseptisée, loin de tous contacts humains. «Allez savoir!» vous résume ce qu’il faut absolument savoir avant le prochain pic saisonnier.
La grippeŠ hélas! Qui n’a connu cet abattement soudain, cette paralysie fiévreuse des jours d’hiver, clouant au lit par une salve d’éternuements et un enrouement carabiné jusqu’au plus impressionnant des colosses? Qui n’a tenté de contrer le sort en cumulant, à l’aube des premiers frimas, petites laines imperméables, jus d’orange fraîchement pressé et longues marches ravigotantes, pour finir brutalement terrassé par ce banal virus? Qui, enfin, ne sait rien des longues séances de transpiration provoquées par des grogs citronnés et alcoolisés censés remettre son humain sur pied? Qui? Ces êtres exceptionnels existent, ils sont rares. Car en vertu de son haut degré de contagiosité et de sa capacité à se répandre comme une traînée de poudre, la grippe s’attaque à la plupart des mortels, au moins une fois dans leur vie.
maladie est connue depuis l’Antiquité. Mais c’est au XIVe siècle à Florence qu’elle reçoit le nom qui traversera les âges: influenza. Quant au mot qui s’impose en français, il tire son origine d’une racine gothique qui signifie saisir brusquement. Autrement dit, la grippe, c’est ce qui «agrippe», souligne Claude Hannoun dans le «Que sais-je» qu’il a consacré à «La Grippe et ses virus». Depuis Hippocrate, soit 400 ans avant notre ère environ, on retrouve des traces d’épidémies pouvant être associées à la grippe dans les documents. Cléopâtre en souffrit donc peut-être. Plus près de nous, c’est Voltaire en visite à Saint-Pétersbourg qui s’est plaint des symptômes de la maladie. Quant à la fameuse pandémie (épidémie mondiale) de grippe «espagnole» de 1918 – baptisée ainsi, alors qu’elle venait d’Asie centrale, car la cour d’Espagne fut sévèrement touchée et parce que la presse répercuta l’événement – elle fut fatale à de nombreuses personnalités: Guillaume Apollinaire, Edmond Rostand, les peintres Klimt et Schiele à Vienne, en moururent.
Pour traiter cette affection si commune, la sagesse populaire regorge de techniques et de remèdes les plus divers. Dans les textes anciens, il est conseillé de rester bien au chaud, par exemple sous des couvertures de laine, un bonnet, voire des vêtements rouges. On prône également la consommation de boissons chaudes et alcoolisées, la protection des yeux, le port de masques ou de voiles transparents. La plupart des régions du monde ont leur méthode, que ce soit le lait chaud fortement arrosé de whisky, parfumé au mielŠ ou le sang de bouquetin. Pour tenter de lever un coin de voile sur les mystères de cette maladie, de séparer ses caractéristiques scientifiques de celles que la sagesse populaire a imposées, «Aller savoir!» a interrogé deux spécialistes.
Le point en sept questions de base :
La grippe est-elle dangereuse?
Capable de provoquer des épidémies d’une rapidité et d’une ampleur inégalées par un autre virus, la grippe peut être meurtrière, on l’a vu. Elle fut fatale à quelque 20 millions de personnes lors de la pandémie de 1918, et elle fait chaque année 400 victimes en Suisse. Daniel Lavanchy, médecin immunologue, responsable du «Programme grippe» à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève, estime pour sa part à des «dizaines de milliers, peut-être plus», le nombre annuel de morts dans le monde. Des études sur le sujet sont en cours.
«Dans des cas hyperexceptionnels, que nous avons tous connu une fois ou l’autre dans notre carrière médicale, oui, la grippe est dangereuse, assure de son côté Bernadette Rime-Dubey, médecin responsable de la médecine du personnel au CHUV. Elle peut alors tuer une personne jeune et en bonne santé, mais c’est la caractéristique de toutes les maladies infectieuses.» Ces cas fort rares sont entraînés par un syndrome de détresse respiratoire, et un état de choc. La gravité de la maladie est toutefois fonction des germes – particulièrement virulents – qui en sont responsables et de l’hôte – en général déjà affaibli sans le savoir – dans lequel ils se fixent.
Sinon, et pour la majorité des gens, la grippe reste une infection bénigne. Exception faite des populations à risque, bien entendu; ainsi les personnes âgées ou cardiaques, par exemple, peuvent être particulièrement touchées. L’infection est en effet susceptible de réveiller des maladies sous-jacentes et d’aggraver des troubles légers des poumons, du c¦ur ou des reins, ou encore de provoquer une surinfection bactérienne. «L’épithélium qui tapisse les voies respiratoires, fragilisé par la grippe, est extrêmement sensible à une maladie bactérienne, telle que la pneumonie, par exemple, ou à un nouveau virus.»
Qu’est-ce que le virus de la grippe?
De taille moyenne, il se présente sous la forme de particules ovales ou allongées. Il se divise en trois catégories A, B et C. «En fait ces virus se ressemblent comme des cousins et présentent les mêmes goûts climatiques pour le froid et l’humidité, mais se collent différemment aux cellules», précise Mme Rime-Dubey. Le virus A est à l’origine des épidémies les plus meurtrières. Moins diffusible, le virus B cause normalement des infections moins sévères et se révèle dans des cas sporadiques ou de petits foyers. Quant au virus C, il n’est d’aucune importance pour l’homme, mais plus difficile à isoler que les autres, il a fait l’objet de moins d’études. Tous ces virus s’inactivent à partir de 61degrés.
«La grande difficulté de les contrer tient à la constante évolution de leurs gènes. A cause de cela, la composition du virus est différente chaque année.» Ces mutations répondent au joli nom de «glissement»; les «cassures» en revanche, à l’origine des pandémies, résultent de mutations profondes et de modifications sévères des structures du virus.
Reste que d’autres infections, dont les symptômes ressemblent fort à ceux de la grippe, sont également causées par des virus, mais différents. Difficile parfois de faire la part des choses entre un bon rhume ou une petite grippe, si ce n’est que cette dernière entraîne normalement une fatigue pouvant durer plusieurs semaines.
D’où vient le virus grippal?
On le trouve partout dans le monde. Mais certaines régions, notamment l’Asie, et la Chine en particulier, en sont des réservoirs privilégiés. «La promiscuité avec des animaux tels que les oies ou les cochons favoriserait les mutations et le départ de nouvelles souches», précise M. Lavanchy. On peut donc supposer que certaines formes de grippe régresseraient, si les conditions et les habitudes de vie changeaient dans ces régions du monde, comme ce fut le cas de la tuberculose en Europe, lorsque le confort s’est accru.
Comment la grippe se transmet-elle?
Par de très fines gouttelettes qui infectent les voies respiratoires, les muqueuses des narines, du fond du nez, de la gorge. Elles peuvent être émises par les personnes infectées, avant même l’apparition des premiers symptômes, en tous cas durant les premières heures de la maladie. En d’autres termes, ce n’est pas forcément le collègue qui nous asperge de ses éternuements depuis plusieurs jours qui est le plus contagieux, mais peut-être bien la voisine, alitée avec une forte fièvre et des courbatures, alors qu’elle respirait la santé il y a quelques heures.
L’incubation de la maladie dure de 24 à 48 heures. En vertu de la prédominance du virus à basse température, sous nos latitudes, nous en sommes donc tous transmetteurs potentiels d’octobre à mars en gros, à moins d’avoir été vaccinés. Dans les autres régions du monde, les pics grippaux sont par conséquent décalés. «Les voyages accélèrent le brassage, mais ces échanges se produiraient de toute façon par le biais des courants et des vents», affirme Mme Rime-Dubey.
Comment se soigner?
La plupart des gens commencent par recourir à la panoplie des remèdes traditionnels, plus ou moins efficaces selon les cas et leur virulence. Si une fièvre importante subsiste après trois ou quatre jours, il n’est pas inutile de consulter un médecin, puisqu’une surinfection bactérienne ne peut être exclue. Les antibiotiques ne s’appliquent d’ailleurs qu’à ce type de complication, ils ne tuent pas le virus grippal.
A l’heure actuelle, seuls deux médicaments sont efficaces pour lutter contre ce dernier: l’amantadine et la rimantadine qui n’est toutefois pas commercialisée en Suisse. Mais ces produits ne sont utilisés que rarement. «Leur emploi n’est pas facile, et ces médicaments relativement coûteux doivent être pris durant une dizaine de jours et à un stade peu développé de la maladie.» Souvent, ils sont donc appliqués trop tard et se bornent à réduire de quelques heures la phase aiguë de la grippe. Restent qu’ils sont fort utiles aux personnes fragilisées, aux asthmatiques par exemple, ou à celles dont les défenses immunitaires sont amoindries, lorsqu’il y a des contre-indications au vaccin grippal.
Comment se prémunir?
Au choix: deux moyens. Le plus exotique consiste à éviter tout contact avec ses semblables durant les six mois ou la grippe présente le plus de risque de se manifester. En hibernant dans une grotte chauffée et aseptisée, ou dans un caisson d’isolation, par exempleŠ Heureusement, ceux que leurs obligations professionnelles et privées obligent à rester en relation avec le reste de l’humanité peuvent aussi recourir au vaccin.
«En vertu des risques élevés de contagion, le vaccin est recommandé aux personnes à risques, dont notamment celles qui souffrent de maladies sous-jacentes, les personnes de plus de 65 ans, l’entourage des gens dont l’immunité est déficiente, ainsi que le personnel soignant», soulève Mme Rime-Dubey. «Même si ce dernier est souvent récalcitrant.» Ainsi, ces deux dernières années, sur les quelque 4500 employés du CHUV, seules 1000 à 1200 personnes ont accepté la vaccination.
Elaborée chaque année au mois de février, la composition du vaccin résulte des recommandations des centres de surveillance mis en place à travers le monde par l’OMS. Les centres nationaux, au nombre de 110 aujourd’hui, sont chargés de suivre l’évolution du virus dans leur pays et d’évaluer le niveau d’immunité de la population face aux virus les plus récents. En Suisse, le laboratoire d’immunologie de l’Hôpital cantonal de Genève joue ce rôle.
Les données sont ensuite transmises aux quatre centres régionaux de Londres, Atlanta, Melbourne et Tokyo. «Ces indications doivent nous permettre de définir le visage du virus de l’année en cours. Il s’agit d’une opération délicate», souligne Daniel Lavanchy. Le vaccin n’est disponible qu’à partir de septembre ou octobre, début des campagnes de prévention en Europe et il reste aujourd’hui le moyen le plus efficace de se prémunir contre la grippe. Mais ceux qui y sont fermement opposés peuvent toujours se consoler par une certitude: une fois qu’un virus a fait le tour du monde, la planète entière est immunisée, du moins jusqu’à l’apparition d’une nouvelle souche.

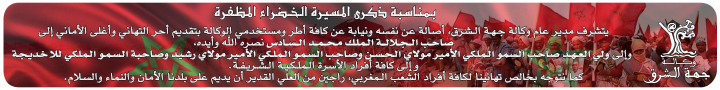


Aucun commentaire