ESTO : oriental ; Acteurs et supports de l’amenagement Territorial

Préambule :
En commémoration du premier anniversaire du discours Royal du 18 mai 2005 portant sur l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), l’Ecole Supérieure de Technologie de l’Université Mohammed Premier d’Oujda a organisé les 11 et 12 mai 2006, en étroite collaboration avec des partenaires potentiels régionaux, nationaux et internationaux, un colloque international « Aménagement territorial et Développement durable : Acteurs et Supports ».
Ce thème fédérateur, en vogue de l’actualité économique et au cœur des préoccupations de tous les pays, a permis de réunir des universitaires, des professionnels, des décideurs publics et opérateurs de différents domaines venus de plusieurs pays (France, Espagne, Belgique, Italie, Tunisie, Algérie, Brésil, Burkina Faso, Oman…).
Cette manifestation d’envergure internationale qui s’inscrit dans les actions d’ouverture de l’Université sur son environnement socioéconomique, a été une occasion de débattre des questions fondamentales ayant trait aux mécanismes et objectifs de la dynamique d’aménagement territorial et du développement durable.
Le trait majeur de cette rencontre a été la grande diversité des thèmes traités couvrant tous les secteurs du primaire au tertiaire, traitant ainsi plusieurs sujets tous en lien étroit avec l’aménagement du territoire et le développement durable : agroalimentaire, environnement, énergie, tourisme, formation, recherche appliquée, patrimoine culturel, transport…..
Les intervenants et participants ont eu l’opportunité d’exposer et de discuter diverses expériences nationales et étrangères. Plusieurs questions et problématiques, en relation avec les politiques d’aménagement territorial, ont été débattues et mises en perspective.
Les travaux du colloque, se sont déroulés sur deux jours, dans deux séances de conférences plénières (matinée du jeudi 11-05-06 et après midi du vendredi 12-05-06) et quatre ateliers thématiques parallèles (après midi du jeudi 11-05-06 et matinée du vendredi 12-05-06).(voir programme)
I. Synthèse et recommandations
Toute politique d’aménagement territorial doit s’inscrire dans une logique de développement durable. Ce développement n’est réalisable qu’avec l’exploitation de tous les facteurs clefs de succès d’un territoire : facteurs sociaux, culturels, naturels, économiques dont recèle le territoire et qui peuvent le rendre compétitif dans un contexte de concurrence exacerbée imposée par la mondialisation.
Le monde connaît des mutations profondes, l’émergence de nouveaux acteurs sur la scène économique (Inde, Chine, Europe de l’Est) font que les territoires s’essoufflent, se cherchent, doivent évoluer, se réformer car ils doivent faire face à la concurrence interne et externe. La création de pôles de compétitivité peut résoudre en partie les problèmes, il s’agit de combiner dans un espace donné entreprises et unités de recherches, de mettre en cohérence leurs compétences afin d’être compétitifs. La qualification des ressources humaines est primordiale. La formation initiale et continue doit s’adapter aux nouvelles exigences du territoire.
Les conditions de la réussite reposent sur la gouvernance du pôle, sur la qualité du pilotage entre les partenaires, le respect des équilibres territoriaux, la logique des projets, et l’évaluation de l’impact.
Le territoire est un espace essentiel de dialogue et de cohésion. Il est l’expression : d’un nouveau dynamisme rural, d’un cadre d’expérimentations, d’innovations sociales, d’initiatives citoyennes et d’une volonté de mieux vivre ensemble.
Conscient de l’ampleur des défis à relever pour corriger les dysfonctionnements économiques et sociaux, le Maroc a entrepris de vastes et ambitieux programmes liés aux infrastructures nécessaires à l’amélioration des conditions de vie des citoyens et des modalités d’ancrage du tissu productif dans les rouages des multiples accords de libre échange déjà conclus ou en cours de finalisation. Ces actions s’inscrivent dans les objectifs de la stratégie nationale d’aménagement du territoire qui vise l’enclenchement d’un processus de développement durable basé sur le maintien des performances économiques et la préservation des équilibres sociaux.
La quête inlassable des conditions de régénérescence dans de véritables bassins de vie pérenne a conduit, après un large processus de concertation, à l’élaboration d’une charte nationale de l’aménagement du territoire, d’un schéma national d’aménagement du territoire et au lancement des schémas régionaux d’aménagement du territoire. Il s’agit d’un effort louable qui a permis de diagnostiquer les forces et les faiblesses de nos différents territoires avant d’arrêter sur cette base des projets territoriaux consensuels, réalisables, viables, innovants et attractifs.
Les grands projets économiques, souvent appréciés par les pouvoirs publics, ne doivent pas faire oublier leur caractère éventuellement dangereux pour l’environnement et donc pour le développement durable et déjà mis en exergue par les expériences de plusieurs pays : risques de littoralisation, de désertification, de surexploitation, de paupérisation qui ont accompagné des schémas d’aménagement trop centralisés et trop axés sur l’économique et l’administratif au détriment du socioculturel et de l’environnemental. Ces expériences ont, cependant, le mérite de nous permettre de ne pas considérer le territoire comme un espace immuable, perçu sous un angle exclusivement administratif, géographique, économique ou social. Tous les territoires, des plus grandes métropoles des pays riches, jusqu’aux plus petits terroirs des pays les moins avancés, sont par essence des lieux de vie, des systèmes complexes, fragiles, dynamiques et, surtout, ouverts. Des systèmes dont les performances dépendent largement de la qualité de leur mode de gouvernance, c’est-à-dire de leurs compétences humaines qui constituent leur principale et ultime richesse. Et c’est de cette diligence que l’Initiative nationale pour le développement humain, inspirée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tire toute sa lettre de noblesse.
Constitué depuis longtemps d’actions normatives, décrétées et mettant en œuvre des moyens importants mais souvent mal gérés, l’aménagement du territoire a correspondu à une vision uniforme d’un territoire national défini par le haut. Aujourd’hui, il est nécessaire de relancer des politiques d’aménagement à la mesure des attentes et des spécificités régionales dans l’objectif de favoriser des territoires de « projets socioéconomiques et culturels innovants », plutôt que des « territoires guichets ».
Les politiques d’aménagement du territoire doivent tenir compte des changements capitaux dans les sociétés, notamment le contexte de mondialisation qui implique que l’aire géographique d’action n’est plus seulement nationale ainsi que l’importance de la tendance actuelle qui va vers la coopération multilatérale.
Pour promouvoir un développement durable au niveau des villes, les solutions se trouvent dans une gestion plus sobre et plus qualitative. Pour y parvenir, il faut que les citoyens soient au cœur de la politique de la ville et que soit menée une gestion intégrée à leur service. La rareté des ressources naturelles et le changement climatique constituent des opportunités d’innovations technologiques et sociales en faveur du développement durable d’où le rôle décisif des collectivités locales, dans la mise en place de démarches novatrices liées à la préservation des environnements écologiques et sociaux qui deviennent de plus en plus vulnérables (développer les énergies renouvelables, réduire les quantités de déchets par le tri sélectif, économie de l’eau…).
Pour la gestion de la ville, il faudrait un nouveau sens des responsabilités, un nouveau sens de la solidarité dans l’espace et dans le temps et un nouveau sens de la citoyenneté.
L’expérience du PNUD pour un développement humain en matière de compétitivité économique territoriale durable a montré que « travailler ensemble » est une condition nécessaire pour un développement durable. Définir un ou plusieurs avantages compétitifs du territoire, identifier les priorités doivent être des décisions collectives. Les instruments à utiliser relèvent essentiellement d’un plan de développement territorial, d’une stratégie de marketing territorial, mais aussi de l’amélioration des systèmes de crédit, de l’appui à la création d’entreprises, de l’organisation des filières productives, des réseaux d’entreprises locales, des réseaux de service nationaux voire internationaux.
L’émergence de la notion de réseau pour réussir une compétitivité économique durable doit s’appuyer sur :
des réseaux d’entreprises locales en districts, filières, chaînes de la valeur… ;
des réseaux de services mettant en commun différentes compétences (financières, technologiques, commerciales…) et appuyant des réseaux productifs ;
des réseaux internationaux de partenariats pour favoriser l’intégration du territoire (le local) dans un contexte global.
La formation peut revêtir différentes formes: formation académique, professionnalisante ou simples séminaires de sensibilisation, l’enjeu est l’adéquation emploi-compétence comme fondement, aujourd’hui, d’un aménagement territorial au service du développement local. Il s’agit de construire un nouveau référentiel Métiers des compétences et des Missions des Agents du développement local et de l’Aménagement du Territoire , de mettre en place des formations qualifiantes et des compétences en matière de gestion de projet du territoire ;de rapprocher le développement local des problématiques plus générales de l’Aménagement du Territoire ; de développer des formations ciblées sur l’interinstitutionnel, l’environnement, le social et l’utilisation de moyens comme les TIC pour aller vers la performance des territoires et l’adéquation de la formation des acteurs face aux demandes du secteur économique.
La délocalisation des départements de formation vers des régions qui ont des problèmes économiques majeurs peut rendre possible leur développement. De plus, les étudiants défavorisés peuvent poursuivre leurs études et trouver des emplois dans différents domaines en fonction des spécificités du territoire. Un département délocalisé donnerait plus de résultats satisfaisants que ceux d’un département cloisonné au sein de l’université. De plus, la collaboration avec les collectivités locales et les entreprises deviendrait plus facile.
Il est enfin exigé de l’université qu’elle contribue à la construction de « pensées aménageantes » au service des politiques d’aménagement des territoires.
En conclusion à cette synthèse, trois idées fortes ont surgi des débats et échanges lors des deux journées des travaux du colloque :
Le développement territorial doit s’inscrire dans une logique de durabilité. La notion de développement territorial durable qui exprime cette exigence intègre tous les facteurs de durabilité qu’ils soient sociaux, culturels, économiques ou environnementaux :
nécessité de corriger les déséquilibres sociaux ;
nécessité de valoriser les ressources locales ;
nécessité de préserver la biodiversité ;
nécessité de favoriser les facteurs de compétitivité économique durable du territoire,
nécessité de préserver sa culture ……
L’objectif étant l’Homme, le Citoyen vivant dans un espace-lieu de vie, un espace -système complexe, un espace-fragile dont il faut préserver l’équilibre.
La synergie entre les différents partenaires locaux : décideurs publics, décideurs privés, société civile et université est impérative. Les notions de réseaux et de système intégré pour appuyer le développement territorial sont à cet égard très importantes. La concertation et la coordination sont les conditions clé de la réussite du développement territorial durable.
La formation et par suite la qualité des ressources humaines joue un rôle primordial dans la réussite du développement territorial durable. Les territoires ne se prévalent pas principalement par une quelconque ressource naturelle, aussi importante soit-elle, quelle soit physique, géostratégique ou financière. C’est dans la qualité des compétences humaines disponibles et dans leur degré d’adhésion à une gouvernance incarnant un projet territorial que réside le principal facteur de succès stratégique d’un territoire.
II. Perspectives
L’omniprésence de la variable sociale et humaine dans la majorité des expériences d’aménagement territorial exposées lors de ce colloque incite à proposer une prochaine manifestation dédiée aux « Articulations entre Développement social et Développement durable »
Entretenir les relations avec les différents participants au colloque en vue d’initier ou de consolider des relations de coopération et de partenariat avec les institutions auxquelles ils appartiennent.
Publication des actes du colloque à paraître au cours du dernier trimestre 2006.

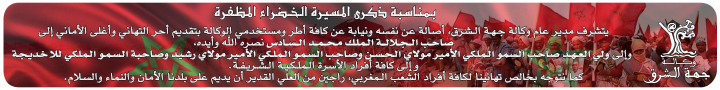


Aucun commentaire
éccelente sythése mon cher prof. Naima BENAZZI …..sans oublier de vous dire je suis un de vos eleves qui n’oubliera jamais vos cours ; votre pedagogie . et vos conseilles pour nous ….فجزاك الله يا استاذتي كل خير ، وأنا فخور بك ولو في كندا ، » وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون » صدق الله العظيم ، وتحياتي اليك والى باقي افراد اسرتك
Bonjour,
Je vous remercie les auteurs de cette conférence. Vraiment est un sujet d’actualité. Mais avant de parler de l’aménagement et le développement du territoire il faut qu’on commence par l’aménagement et le nettoyage de certaines mentalités qui gouvernent et prennent des postes loin de
sujet d’actualité au Maroc l’aménagement de territoire est
Dr. MILOUA Fodil
Université de Sidi-Bel-Abbès.
Le grand projet auquel il faudrait donner au préalable la priorité, c’est l’activation du processus de la construction maghrébine. Tous ces projets de développent durable et d’aménagement de territoire ne peuvent avoir de sens sans cette union, garante de flux de ressources humaines et énergétiques, et gage de stabilité. Les pays européens n’ont trouvé la prospérité qu’après l’accord de l’union entre l’Allemagne et la France ennemis de toujours.
Chercheur,
Je suis toute à fait d’accord avec vous Dr. Miloua. Mais croyez-vous, cette construction maghrébine, sera réalisée tant que l’Algérie soutient le Front de POLISARIO?
Pensez-vous que l’Algérie défend le droit du peuple dans son autodétermination ? Si oui, pourquoi ne défend pas le droit du peuple palestinien qui souffre depuis 1948 ?
Ne vous croyez pas que l’Algérie est le grand handicap « Pierre angulaire » de la réalisation de ce projet avec le témoignage de la plupart de grands pays dans le monde ?
Donc, le projet de la construction maghrébine est trop loin et difficile à concrétiser tant que l’Algérie pense à morceler le Maroc. En revanche, il est très facile à réaliser quand l’Algérie se réveille et prend le droit chemin vis-à-vis le pays voisin.
Je profite de l’occasion pour dire à Bouteflika que tu as oublié ton lieu de naissance, où tu as effectué tes études, où tu as travaillé !!!! C’est à Oujda Monsieur le président et Oujda se trouve au Maroc. Et là tu veux morceler ton ancien pays. Ce n’est pas bon : on est des musulmans en plus. C’est grave.
Bon courage