ETUDE D’EVALUATION DE l ‘ HORAIRE CONTINU : RAPPORT GENERAL juin 2007 – 10-

V. RECOMMANDATIONS ET MESURES DE
CORRECTION
Suite aux différentes étapes de cette étude, il convient d’affirmer que la réforme de l’horaire
continu constitue effectivement une action de modernisation de l’administration marocaine.
En effet, la majorité des objectifs escomptés de la réforme a été réalisée.
Toutefois, afin de consolider les gains actuels et corriger les anomalies identifiées,
inhérentes à l’application du nouveau système horaire, il est nécessaire de déterminer
certaines mesures correctives qui permettront de tirer le plus grand profit de la réforme
horaire.
Dans cette optique, les actions à entreprendre pour l’optimisation du système de l’horaire
continu peuvent être subdivisées en 6 grands volets à savoir :
la restauration des fonctionnaires ;
le contrôle de présence des fonctionnaires ;
le transport des fonctionnaires ;
l’adéquation de l’horaire continu aux autres pratiques horaires ;
l’optimisation d’impact de l’horaire continu.
1. RESTAURATION DES FONCTIONNAIRES
Une année et demi après l’instauration du nouveau système horaire, le taux de mise en
place des restaurants administratifs se situe à (14,8%) des établissements disposant des
restaurants au niveau national et à (37,0%) au niveau des administrations centrales. Cette
situation reste encourageante compte tenu de la contrainte budgétaire des administrations.
Actuellement, la restauration collective dans les administrations reste dominée par les petits
et moyens restaurateurs et le mode de fonctionnement des restaurants n’est pas réglementé
de manière formelle, celui-ci variant d’une administration à une autre.
La restauration des fonctionnaires constitue un des principaux facteurs de leur adaptation au
nouveau système horaire.
Dans ce contexte, l’identification et l’application des axes de développement des restaurants
administratifs deviennent de plus en plus urgentes pour la réussite de la réforme horaire.
Lesdites mesures se présentent comme suit :
Mettre en place un plan de financement progressif des restaurants collectifs ;
Potentielles sources de financement :
– Redéploiement des économies réalisées sur la consommation d’énergie ;
– Intégration du problème de la restauration des fonctionnaires dans la politique
sociale globale du Maroc ;
Externaliser le service de la restauration des fonctionnaires ;
Définir clairement le mode de gestion des restaurants collectifs : rôle de
l’administration et celui du prestataire, mode de paiement, organisation pratique.
RAPPORT GENERAL 74 © Capital Consulting – 2007
ETUDE D’EVALUATION DE L’HORAIRE CONTINU
PHASE DE SYNTHESES ET CONCLUSIONS
Redéfinir le rôle des associations des oeuvres sociales dans la restauration des
fonctionnaires :
– Interlocuteurs des fonctionnaires auprès de l’administration et du prestataire pour
le bon fonctionnement du restaurant
– Facilitateurs dans la mise en oeuvre pratique des solutions
Mutualiser le service de la restauration entre les différentes administrations : création
d’une commission interministérielle mixte pour étudier la faisabilité d’une telle action
et ses modalités pratiques de mise en place ;
Ajuster les prix des repas : mise en place d’un système de péréquation des prix qui
consiste à faire payer aux fonctionnaires des prix en fonction de leur grades
hiérarchiques ;
Instituer les chèques restaurants : engager une discussion avec la fédération des
restaurateurs pour les modalités pratiques de mise en oeuvre.
2. CONTROLE DE PRESENCE DES FONCTIONNAIRES
Le respect du volume et de la plage horaires fixés par le décret instaurant l’horaire contenu
requiert la mise en place d’un système de contrôle de présence efficace. A cet effet,
l’installation des pointeuses est pratiquement généralisée au niveau des administrations
centrales. Le problème réside actuellement dans l’exploitation des données recueillies et
l’extension de ces modèles de contrôle au niveau des services extérieurs. Globalement les
principales actions à entreprendre pour la mise en place de cette mesure
d’accompagnement se résument comme suit :
Généraliser les pointeuses : intégrer les services extérieurs dans la recherche et la
mise en place des solutions ;
Mettre en place une cellule issue de la direction des ressources humaines pour
l’exploitation des données recueillies par les pointeuses ;
Mettre en place un système de flexibilité horaire : laisser aux fonctionnaires une
marge temporelle au niveau des entrées et des sorties pour leur permettre de mieux
s’adapter à l’horaire continu ;
Définir les dispositions réglementaires et/ou juridiques relatives aux sanctions à
adopter en cas d’absentéisme ou de non respect notoires de la plage horaire ;
Prendre des mesures pour assurer la permanence du service au niveau des
guichets.
3. TRANSPORT DES FONCTIONNAIRES
Certains problèmes liés au transport du personnel ont été identifiés lors de la phase
qualitative de l’étude comme des contraintes qui entravent l’exploitation maximale des
bienfaits de l’horaire continu par les fonctionnaires. Il s’agit essentiellement du retard
qu’accusent les fonctionnaires au niveau de l’entrée au bureau et du retour à leur domicile.
Dans cette situation, certains fonctionnaires considèrent qu’ils ne disposent pas
suffisamment du temps libre pour profiter de l’horaire continu.
Pour pallier ces problèmes, les administrations publiques sont appelées à entreprendre les
actions citées ci-dessous :
RAPPORT GENERAL 75 © Capital Consulting – 2007
ETUDE D’EVALUATION DE L’HORAIRE CONTINU
PHASE DE SYNTHESES ET CONCLUSIONS
Externaliser le service du transport des fonctionnaires ;
Mutualiser le service du transport du personnel entre les administrations : la
commission interministérielle à mettre en place pour la restauration aura également
en charge le dossier du transport ;
4. ADEQUATION DE L’HORAIRE CONTINU AUX AUTRES PRATIQUES HORAIRES
L’horaire discontinu est le système appliqué dans le secteur scolaire et dans la plupart des
entreprises marocaines. Cette divergence de l’horaire continu avec l’horaire appliquée dans
des secteurs aussi importants que sont le scolaire et le secteur privé n’est pas sans
incidence sur l’appréciation du nouveau système horaire.
Selon les résultats de l’analyse d’adéquation de l’horaire continu à l’horaire scolaire et ceux
de l’enquête auprès des entreprises, les mesures à entreprendre pour corriger ces
défaillances se présentent comme suit :
Secteur scolaire : le ministère de l’éducation devrait, conjointement avec le M.M.S.P,
renforcer la politique de mise en place des horaires adaptés aux réalités
géographiques des différentes régions du Royaume ;
Secteur privé : encourager les entreprises à adopter l’horaire continu comme horaire
de travail.
5. OPTIMISATION D’IMPACTS DE L’HORAIRE CONTINU
L’optimisation d’impacts de l’horaire continu concerne les actions à entreprendre pour que,
d’une part une plus grande part des fonctionnaires puissent pleinement profiter du
supplément de temps libéré par l’horaire continu et, d’autre part pour que les objectifs de
réduction des dépenses de fonctionnement puissent être entièrement réalisés.
En effet, à titre d’exemples seulement (30,8%) des fonctionnaires ont entrepris une activité
sportive ou un loisir suite à l’adoption du nouveau système. Uniquement (3,8%) des
enquêtés vont au cinéma ou au théâtre. Pour ce qui est des dépenses quotidiennes des
administrations, le taux de réduction de (4,6%) relevé, pourrait être amélioré.
Globalement pour optimiser l’impact de l’horaire continu sur ces axes, il faudrait :
Développer progressivement les infrastructures liées aux activités culturelles,
associatives et sportives au niveau de l’administration (association des oeuvres
sociales) et des collectivités locales ;
Poursuivre rigoureusement les mesures de rationalisation des dépenses dans les
administrations publiques.
RAPPORT GENERAL 76 © Capital Consulting – 2007
ETUDE D’EVALUATION DE L’HORAIRE CONTINU
PHASE DE SYNTHESES ET CONCLUSIONS
CONCLUSION GENERALE
La présente étude ayant porté sur « l’évaluation de l’horaire continu, une année après son
instauration dans les administrations publiques » a permis de déterminer :
les opinions des fonctionnaires, des usagers et des entreprises à l’égard de l’horaire
continu ;
l’état de mise en oeuvre des restaurants dans les administrations publiques ;
les répercussions de l’horaire continu sur la vie professionnelle du fonctionnaire:
rendement, motivation, temps de présence, organisation du travail et sur la vie
personnelle du fonctionnaire : temps libre, activités extraprofessionnelles, dépenses
quotidiennes…etc ;
Le changement intervenu dans les dépenses courantes des administrations :
consommation de l’électricité, l’eau, le téléphone, le carburant et les frais d’entretiens
des véhicules ;
Les retombées de l’horaire continu sur la création d’emploi dans le secteur de la
restauration ;
Les perspectives d’adéquation de l’horaire continu à l’horaire scolaire.
Globalement, les indicateurs retenus sont favorables à l’horaire continu. En effet, le nouveau
système est apprécié par l’ensemble des acteurs (fonctionnaires et usagers). Il aurait eu un
impact positif sur l’efficacité du service administratif, l’épanouissement des fonctionnaires,
les dépenses courantes des administrations, la consommation d’énergie et la création
d’emploi dans le tertiaire.
Le schéma d’appréciation retenu se compose de (65%) de fonctionnaires favorables à
l’horaire continu contre (35%) de non favorables. Les principales variables explicatives du
comportement des fonctionnaires sont :
les variables sociodémographiques : l’âge, l’état matrimonial, les enfants à charge et la
situation professionnelle du conjoint ;
les variables socioprofessionnelles : le niveau d’ancienneté dans l’administration ;
les variables spatiales : la taille des villes et la distance entre le lieu de travail et le
domicile.
En plus de ces facteurs, l’infrastructure et le mode de restauration des fonctionnaires
déterminent significativement leur niveau d’adaptation à l’horaire continu.
Par ailleurs, l’étude révèle que l’horaire continu reste le système horaire le plus adéquat pour
les usagers du service public notamment grâce aux bienfaits observés sur l’amélioration
globale de la qualité du service suite à l’adoption du nouveau système. En effet, (65%) des
usagers sont favorables à l’horaire continu contre (35%) de non favorables, et prés de troisquarts
des entreprises enquêtées estiment que l’horaire continu est adéquat.
Pour ce qui des mesures d’accompagnement, , le taux de mise en place des restaurants
administratifs se situe actuellement à (14,8%) des établissements disposant des restaurants
au niveau national et à (37,0%) au niveau des administrations centrales. Cette situation reste
encourageante compte tenu de la contrainte budgétaire des administrations. L’installation
RAPPORT GENERAL 77 © Capital Consulting – 2007
ETUDE D’EVALUATION DE L’HORAIRE CONTINU
PHASE DE SYNTHESES ET CONCLUSIONS
des pointeuses est pratiquement généralisée au niveau des administrations centrales. Le
problème réside actuellement dans l’exploitation des données recueillies et l’extension de
ces modèles de contrôle au niveau des services extérieurs.
Sur le plan économique, le nouveau système horaire aurait permis de réaliser une économie
globale de (4,6%) sur l’ensemble des dépenses courantes des administrations publiques.
Les économies réalisées sont de l’ordre de (6,1%), (17,9%) et (1,8%) pour les dépenses
d’électricité, d’eau et de téléphone respectivement. Concernant la consommation du
carburant et les frais d’entretiens des véhicules, les économies réalisées s’élèvent à (24,7%)
à prix courants et à (30,5%) à prix constants pour le parc du transport du personnel des
administrations centrales. Ce qui correspond financièrement à un gain de 6 683 194 DH/an à
prix courants et 8 259 296 DH/an en tenant compte des variations des prix.
S’agissant des créations d’emplois dans le tertiaire, à moyen terme, après une généralisation
des mesures d’accompagnement de l’horaire continu et une adhésion de 80% des
fonctionnaires aux restaurants administratifs, les prévisions de créations d’emplois sont
estimées à 2022 postes et 23596 postes pour les administrations centrales et l’ensemble des
administrations publiques respectivement.
Afin de consolider les gains actuels et optimiser le nouveau système horaire, les actions
énumérées ci-dessous ont été identifiées comme des mesures d’accompagnement de la
reforme à entreprendre :
Généraliser les restaurants administratifs ;
Renforcer le dispositif du contrôle de présence des fonctionnaires;
Redéfinir les modalités du transport des fonctionnaires ;
Poursuivre la modernisation du mode de gestion de l’administration ;
Prendre des mesures pour assurer la permanence du service au niveau des guichets
administratifs ;
Développer les infrastructures liées à la garderie et à la restauration dans les
établissements scolaires ;
Encourager les entreprises à adopter l’horaire continu comme horaire de travail.
L’étude confirme la grande majorité des attentes de la réforme ; et renforce ainsi la nécessité
de maintenir l’horaire continu comme système horaire de travail dans les administrations
publiques. Ces résultats font de la réforme horaire une véritable action de modernisation de
l’administration marocaine et un levier non négligeable du développement économique et
social du Royaume.
RAPPORT GENERAL 78 © Capital Consulting – 2007
ETUDE D’EVALUATION DE L’HORAIRE CONTINU
PHASE DE SYNTHESES ET CONCLUSIONS
ANNEXE 1 : RAPPEL DE LA METHODOLOGIE
GENERALE DE L’ETUDE
1. DEMARCHE METHODOLOGIQUE ADOPTEE
Dans l’optique des objectifs assignés à l’étude, la méthodologie générale adoptée s’est
articulée autour des quatre phases citées ci-dessous:
La phase de cadrage méthodologique qui nous a permis de définir la démarche
globale suivie, d’identifier la population cible et de mettre en place le plan de sondage
concernant la phase d’investigation (Cibles, échantillons, mode d’administration des
questionnaires, choix des estimateurs).
La phase d’investigation durant laquelle toutes les informations nécessaires pour
répondre aux objectifs de la mission ont été collectées. Elle s’est subdivisée en deux
étapes :
– une enquête qualitative (Entretiens et Ateliers de travail)
– une enquête quantitative (administration des questionnaires)
La phase d’analyses et d’interprétations des résultats qui consistait à
l’harmonisation et l’analyse des différentes données recueillies
La phase de synthèses et conclusions qui consiste à traduire les différents
résultats de l’étude sous forme de recommandations et mesures d’accompagnement
à entreprendre pour l’optimisation du système de l’horaire continu.
Ci-après un schéma récapitulatif des différentes interventions de l’étude :
RAPPORT GENERAL 79 © Capital Consulting – 2007
ETUDE D’EVALUATION DE L’HORAIRE CONTINU
PHASE DE SYNTHESES ET CONCLUSIONS
Plan de Qualité Projet
(PQP)
– Questionnaires
– Rapport de fin de
phase
Harmonisation des
données provenant
de diverses sources
Phasage de la mission
Identification de la
population et des
cibles
Axes : Axes : Axes :
Enquête quantitative
– Analyse de la
documentation et
des résultats de
l’enquête qualitative
– Conception des
questionnaires et
enquête pilote
– Administration des
questionnaires
– Collecte des
données
Enquête qualitative
– Entretiens
– Réunions et ateliers
de travail
Elaboration des
indicateurs d’étude
et Analyse
descriptive
– Rapport général de
présentation de l’étude
contenant les synthèses et
recommandations
Formalisation du
document de
synthèse
Axes :
Elaboration du
rapport général
de l’étude et le
rapport de
synthèse des
recommandations
Echantillonnage
Analyse des données
Formalisation du
rapport général
Identification des
leviers d’action
directs, indirects et
pertinents
Détermination des
outils d’investigation
et d’analyses
Etude documentaire
Contenu
Livrables :
– Rapport de fin de
phase
Cadrage
méthodologique
Analyse et
interprétation
des résultats
Synthèses et
conclusions
Phases : Investigation
Synoptique général du déroulement de la mission
RAPPORT GENERAL 80 © Capital Consulting – 2007
ETUDE D’EVALUATION DE L’HORAIRE CONTINU
PHASE DE SYNTHESES ET CONCLUSIONS
2. PRINCIPALES INVESTIGATIONS DE L’ETUDE
La phase d’investigation, qui a constitué la principale étape de la mission, s’est consacrée à
la production de toutes les informations nécessaires pour répondre aux objectifs de la
mission. Elle est constituée d’une enquête qualitative suivie d’une enquête quantitative.
2.1 L’ENQUÊTE QUALITATIVE
L’enquête qualitative se décline en deux parties : les entretiens avec des responsables
administratifs et les ateliers de travail avec les fonctionnaires.
Les entretiens, qui constituent la principale composante de l’enquête qualitative, se sont
adressés aux DRHs des ministères de l’échantillon, aux syndicats professionnels (CDT,
UGMT, UNTM) et à un organisme benchmark (CDG).
Les ateliers de travail constituent la deuxième composante de l’enquête qualitative. Ils
se sont adressés aux fonctionnaires des différentes échelles de la fonction publique et
nous ont permis de recueillir librement leurs avis sur l’horaire continu et ses retombées.
Globalement, cette première étape nous a permis de concevoir des questionnaires plus
appropriés et de répondre aux objectifs qualitatifs de l’étude.
2.2 L’ENQUÊTE QUANTITATIVE
L’enquête quantitative est la principale investigation de l’étude ; elle consiste à concevoir
les questionnaires, les administrer et recueillir les réponses auprès des trois catégories
de la population cible à savoir les fonctionnaires, les entreprises usagères et les citoyens
usagers. Elle s’est articulée comme suit :
La spécification du plan de sondage : ceci concernait l’identification complète des
échantillons, des modalités de la conduite de l’enquête sur le terrain et du choix des
estimateurs d’analyse;
La conception des questionnaires et la réalisation de l’enquête pilote : il s’agit
de concevoir, tester et valider les différents types de questionnaires correspondant
aux trois catégories de la population cible (Fonctionnaires, Entreprises et citoyens) ;
L’enquête principale qui consiste à administrer les différents questionnaires et à
recueillir les réponses.

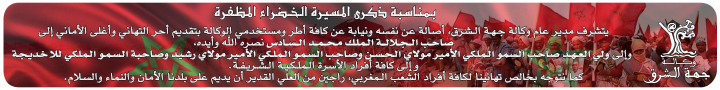


Aucun commentaire