les derniers mineurs de jerada
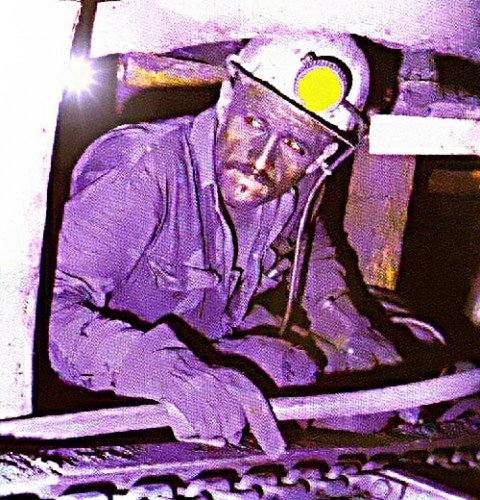
Au bout de la nuit et du
voyage vers l’Oriental, en ce mois de décembre glacial, le ciel matinal et gris
d’Oujda nous accueille. A cinquante kilomètres plus au sud, je me rends à
Jérada, cité de mineurs en fin de parcours. Radioscopie d’une ville en quête
d’avenir.[i]
Par Abdelkader Mana
JERADA, UNE NOUVELLE ATLANTIDE ?
Depuis sa reconnaissance par les géologues
en 1929 et son exploitation effective en 1936 , le bassin carbonifère de
Jérada avait transformé cette région agricole en zone minière. Prochainement,
en l’an de grâce 2001, le dernier puits sera fermé, et le dernier mineur prié
de redevenir le fellah qu’il a toujours été. Difficile reconversion, quand on
sait que la mine a crée autour d’elle une communauté de destins, une identité
propre à ceux qui ont partagé les joies de la fête, mais aussi les ruines
invisibles de la silicose : inhalé au fond des galeries souterraines, le
dépôt cristallin de poussière noire finit par durcir et obstruer l’appareil
respiratoire, y étouffant progressivement la vie. Incurable est la silicose,
parce qu’elle adhère irrémédiablement aux parois pulmonaires. L’inertie se
substitue progressivement à la plasticité cellulaire, le mort se saisit du vif.
La mine ferme, les damnés de la silicose restent : plus de travail à la
mine, plus de travail ailleurs, que vont-ils devenir ?
Ce simple mot,
« Jérada » (sauterelle en arabe), produit en moi, comme « une
déflagration du souvenir » . Il me rappelle étrangement cette vieille
comptine dont jadis nos grands – mères berçaient en nous l’enfant qui
rêve :
« Â Jérada Maalha !
Fiin kounti saarha ? »
O sauterelle bien salée !
Vers quelle prairie t’en es-tu allée ?
C’était au temps des disettes et
des vaches maigres, où des nuées de sauterelles décimaient les champs, et où il
ne restait aux hommes affamés qu’à se gaver de grillades de sauterelles salées.
Nuée de pique-bœufs dans le ciel
d’Oujda. Au bord de la route des « trabendistes » proposent à vil
prix de l’essence en noir, qu’ils sont allés chercher en Algérie toute proche.
Ici, le « trabendo », terme par lequel on désigne toutes sortes de
transactions, semble tourner au ralenti, non seulement des lenteurs des réveils
ramadanesques, mais à cause de la double fermeture : celle de la frontière
algéro-marocaine et celle de la mine carbonifère de Jérada.
Sauterelles et hérisson
Les champs reverdissent déjà de leurs
jeunes pousses de fraîcheur. Il a dû pleuvoir sur ces étendues steppiques et
dépeuplées couvertes d’alfa, sur ces petites crêtes dénudées qui ferment l’horizon
plus au sud, et sur cette haie d’arbres, dressant vers le ciel leurs branchages
fantomatiques et nus. Par delà les collines dénudées et les amandiers en
fleurs ; la traversée de l’oued Isly, connu pour la bataille éponyme qui
oppose en 1844 un Maroc qui soutenait les incursions de l’Emir Abdelkader
depuis le Rif jusqu’en Algérie qui venait alors d’être occupée par la France. Par delà les
frontières, histoire commune, proximité géographique : ici -même le jeûne
est rompu aux dattes d’Algérie. Par delà les étendues steppiques et les
rivières partagées, mêmes goûts musicaux : le Raï d’Annaba est apprécié à
Jérada et le Gharnati de Tlemcen à Oujda. Par delà les conjonctures politiques,
croisement de destins et affinités électives l’emportent de loin.
Traversée de
« Guenfouda » (hérisson en arabe), localité née, non pas autour d’un
marché hebdomadaire rural, mais plutôt autour d’une activité minière :
dans des hangars de type colonial, on transformait jadis le minerai de charbon
en « boulets » destinées à l’exportation. Tout semble indiquer que la
région vit non pas du sol laissé en friche pour la vaine pâture, mais des ses
énergies telluriques. Ici, l’activité minière a finit par l’emporter de loin
sur l’activité agricole, vidant du même coup celle-ci de sa substance humaine,
comme semble l’indiquer ces immenses étendues où l’on a du mal à apercevoir ne
serait-ce qu’un épouvantail.
« Qu’allons-nous devenir
seuls au milieu des
ruines? »
Après le plat pays, le massif
montagneux. Le bassin carbonifère est situé au sud de cette montagne. M’étant
assuré que « Guenfouda » (hérisson) n’est pas encore Jérada
(sauterelle) – les toponymes ont ici des airs de totems – je m’assoupis. Au
réveil, j’y suis déjà comme au sortir d’un rêve. C’est donc cela Jérada ?
Une immense joutia (marché aux puces) de bric à brac, un baraquement de
taudis en briques, urbanisme sans allure, éclaté au milieu de montagnes de
remblais de charbon. Au pied du minaret délavé de la place centrale – y a-t-il
vraiment un centre à Jérada ? – on marchande, la mine grise, de maigres
étalages d’oranges et de poissons faméliques pêchés je ne sais où. C’était donc
cela la ville minière ?
Tout autour de la place, des
échoppes de bricolage : ateliers d’électricité, mécanique, plomberie,
menuiserie, chaudronnerie. On vend de tout, on répare de tout, on a même ouvert
une « Jérada Internet » ! C’est en ces mille et un petit métiers
que ce sont reconverties les anciennes gueules noires . Une reconversion
qui ne concerne que les ouvriers de surface mais pas les charbonniers du fond
dont le seul savoir – faire est justement d’aller au charbon. Minés par la
silicose, désoeuvrés par inaptitude ou pour cause de fermeture définitive du
puits dans lequel ils passaient le plus sombre de leur temps, ils déplorent
néanmoins la fermeture de la mine dont ils extrayaient au risque de leur vie,
leur raison d’être et leur dignité d’hommes. Depuis que du fond de la terre –
mère, les énergies telluriques ne font plus surface, depuis que les puits se
sont mis à fermer l’un après l’autre, la ville née et autour de la mine ne sait
plus de quoi demain sera fait.
Une mosaïque de tribus
L’argent circule peu dans cette
ville où la mine n’est plus qu’un puits sans fond ni issue. Une ruine dont on
extrait plus d’énergie – pour continuer à faire tourner la centrale thermique,
on importe désormais un combustible douteux – et encore moins de
richesse : « Il y a encore des réserves de charbon pour un siècle,
mais on a décidé de fermer les charbonnages, nous explique cet ancien ouvrier
de surface. Question de politique. La mine ne faisait pas seulement vivre
Jérada, elle profitait aussi à la ville d’Oujda. Après la fermeture, certains
mineurs sont restés sur place, mais beaucoup d’autres sont retournés dans leur
patelin d’origine dans le sud ou à Berkene ».
En raison des départs
pour fermeture de la mine,
la cité ouvrière est
actuellement
en démolition.
On me conseille d’aller
rencontrer un certain Mohamed Lashab, un syndicaliste qui aurait participé aux
négociations conduisant à la fermeture de la mine : « Je vis ici
depuis 1945, dit-il. Quand je suis arrivé à Jérada, j’avais à peine trois ans.
Maintenant, je suis à la retraite. On est venu de Debdou où mon père ne pouvait
plus vivre de la petite agriculture. Des membres de sa famille qui
travaillaient déjà à la mine en 1945
l’avaient incité à les y rejoindre ». Le recrutement
s’opérait souvent de la sorte : les mineurs originaires de régions rurales
pauvres, une fois établis sur place, faisaient venir voisins et famille de leur
village d’origine, leur servant dans un premier temps de « structure
d’accueil ». c’est la cas d’Afenzy, né à Demnate en 1950, venu travailler
comme mineur au début des années quatre – vingt « parce qu’il y avait des
gens de Demnate qui travaillaient déjà ici ». C’est le cas d’Ahmed, né
aussi en 1950 chez les Béni Lent, fraction Tsoul, dans la région de Taza, venu
à Jérada en 1972 pour rejoindre son frère qui travaillait déjà dans la mine.
Ainsi, de fil en aiguille, Jérada, mi-ville, mi-village, s’est composée de
quartiers et de douars dont les habitants avaient pratiquement la même origine.
Ce qui explique que les quartiers portent les noms de régions lointaines :
Sous, Marrakech, Taza, Debdou, Demnate, Béni Yaâla, Oulad Sidi Ali, Oulad Âmer,
Zkara, Oulad Maziane. Il y a même des membres de la même tribu qui habitent des
sous – douars : Laghouate installés au douar Oulad Âmer, Béni Guil au
douar Oulad Maziane (ces derniers sont des éleveurs connus pour la qualité de
leur mouton « Guilli »).
Jérada était ainsi composée d’une
mosaïque de tribus, comme en témoigne Malika El Kihal, fille de l’un des
premiers mineurs : « De mon enfance, je garde l’image de la place
centrale de Jérada où, à l’occasion d’une fête religieuse ou nationale, on
pouvait assister à tous les folklores du pays. Le personnel organisait une fête
saisonnière , l’Ouaâda , qui était à la fois un rite de passage et un
pèlerinage » . La ville était structurée en fonction des activités de
la mine : il y avait la cité ouvrière, la cité des agents de maîtrise et
« la cité Russe » (édifiée dans les années soixante – dix par les
Soviétiques venus monter la centrale thermique) où résident les ingénieurs. Du
temps du Protectorat, se souvient-on, les agents qui occupaient la cité ouvrière
n’avaient pas le droit d’entrer ni de se promener dans la cité des agents de
maîtrise, alors occupée par les Français.
JERADA
Beaucoup de vendeurs mais pas
d’acheteurs
En pleine activité, la mine
produisait jusqu’à 700 000 tonnes de charbon par an et employait 7000
personnes. Ce qui faisait vivre jusqu’à 70 000 âmes. En raison des départs
pour fermeture de la mine, la cité ouvrière – noyau primitif de Jérada – est
actuellement en démolition. Dans les autres quartiers qui restent encore
debout, on peut lire l’inscription « à vendre » sur les façades de
nombreux taudis. Mais comme il n’y a pas d’acquéreurs, leurs propriétaires
finissent par les abandonner . C’est le cas d’un certain Zeroual, originaire du
Sous, qui a abandonné sa maison, pas de son plein gré, mais parce que dans sa
ruelle, les maisons voisines ont été brutalement désertées : vidée de
toute vie, elles ne sont plus que des ruines hantées par l’esprit des disparus.
Les ruelles fantômes font désormais peur à ceux qui sont restés. La femme de
Zeroual et ses enfants ont réclamé de quitter les lieux à tout prix :
« Qu’allons – nous devenir seuls au milieu des ruines ? » demandaient-ils
à Zeroual qui voulait d’abord vendre la maison avant de partir. Il voulait
aussi retarder son départ parce qu’il attendaient le verdict du tribunal sur le
litige qui l’opposait depuis des années aux charbonnages. Finalement, il a eu
gain de cause : les tribunaux ont rendu leur jugement en sa faveur pour
qu’il réintègre son travail dans une mine qui n’existe plus ! Comme il n’a
pas non plus trouver d’acquéreur pour sa maison, Zeroual a dû se rendre à
l’évidence : il a plié bagage et s’en est retourné dans sa tribu d’origine
dans le Souss. Il était bien commode de penser qu’en guise de reconversion les
mineurs n’avaient qu’à retourner travailler la terre qu’ils avaient quitté.
Mais le hic et le nunc est qu’entre temps ces ex-mineurs se sont
urbanisés : on en est au moins à la troisième génération de mineurs depuis
le début de l’exploitation de la mine en 1936. Et leurs enfants, qui sont pour
beaucoup des diplômés – chômeurs, ne voient pas leur avenir dans un
« retour à la terre des ancêtres ». ces jeunes s’attendaient plutôt à
prendre la relève de leurs parents en tant que « cadres de la mine ».
Or, avec la fermeture de celle-ci, ils se voient brusquement sans perspectives,
condamnés « à se tourner les pouces et à croiser les bras », comme
avoue un jeune titulaire d’une licence en mathématique, au chômage. Certains
ex-mineurs investissent une part des indemnités qu’ils ont reçu des
charbonnages en finançant l’émigration clandestine de leur progéniture. Un
drame en cache un autre : pour avoir fait naufrage dans le détroit de
Gibraltar, on ne verra plus jamais certains de ces jeunes candidats à l’exil.
Au lieu de partir, beaucoup ont cependant préféré rester sur place, choisissant
d’investir leur indemnités de départ dans le petit commerce ou la création
d’ateliers, comme l’explique un mineur à la retraite :
« On veut faire disparaître
Jérada alors qu’on sait pertinemment que la mine pourrait encore continuer à
produire pendant deux siècles. Après la fermeture les ouvriers ont crée de
petites entreprises avec leur savoir faire en menuiserie, des ateliers
électriques ou de nettoyage. Mais les effectifs ne dépassent guère une
trentaine de personnes, y compris les associés d’une société charbonnière. Cela
ne constitue pas vraiment une reconversion vers d’autres activités dont la ville
a pourtant cruellement besoin ».
Les jeunes s’attendaient
à prendre la relève de leurs
parents
en tant que « cadres de
la mine »…
A l’emplacement même du premier
puits dont l’exploitation remonte à 1936 – là où se trouvent les locaux de la
direction – les Charbonnages du Maroc (CDM) ont cédé des ateliers à leurs
anciens techniciens pour qu’ils y créent leur propre entreprise. Louables
intentions, encore fallait-il y préparer les salariés avant de plier bagage.
Car on ne métamorphose pas du jour au lendemain en d’ingénieux gestionnaires
d’entreprises de simples salariés qui ont vécu toute leur vie dans un cadre
régi par une discipline de fer et où ils n’avaient aucun droit à l’initiative.
Résultat : échec de la reconversion. D’où l’angoisse des « bénéficiaires »,
face à la précarité et à l’incertitude d’une situation qui les désarme, tant
psychologiquement (ils n’ont jamais appris « le goût du risque »)
qu’économiquement (ils n’ont pas une assise financière suffisante pour la
maintenance et la traversée du désert). Nos nouveaux entrepreneurs donnent
plutôt l’impression de regretter la situation confortable que leur conférait
leur statut de salarié. Certes, ils ne gagnaient pas beaucoup, mais au moins
ils savaient à quoi s’en tenir à la fin de chaque mois : « On
n’arrive même plus à retrouver la moitié de notre ancien salaire », se
lamente cet associé de l’entreprise qui s’est substituée à l’ancien atelier
d’électricité.
Une reconversion difficile
L’isolement et l’enclavement de
Jérada n’arrange pas non plus les choses et nos associés n’ont ni les moyens ni
la formation requise pour faire connaître leurs services à une clientèle
potentielle, dont ils devinent l’existence mais qu’ils ne savent pas
atteindre : les commandes sont rares et
irrégulières : « Même la centrale thermique préfère réparer son
matériel défectueux à Casablanca plutôt que dans nos ateliers. Or, si les
commandes continuent à nous faire défaut, nous risquons de fermer dans deux à
trois mois au plus tard ». Même son de cloche à l’atelier mécanique,
concédé lui aussi à d’anciens techniciens de la mine : « à ce
jour, nous n’avons pas touché un centime. Si la situation ne change pas d’ici à
six mois, nous serons obligé d’abandonner. Pour le moment, on survit grâce aux
charbonnages, mais nous serons bientôt condamnés à perdre ce seul client
puisque la mine va fermer. Nous espérons que la centrale thermique de Jérada
nous fera une proposition de convention remplaçant celle que nous avions avec
les charbonnages. L’argent ne circule plus, le rawaj a disparu, les
boutiques ont fermé, des habitations sont en vente. Ne reste ici que ceux qui
n’ont pas où partir ». Faute de retrouver une activité de substitution, la
ville se meurt. Une mort lente symbolisée par la présence de la silicose :
« Une maladie incurable et mal indemnisée », précise le syndicaliste.
« Pour moi, un homme atteint à 30% d’IPP(Invalidité Physique Professionnelle,
sigle par lequel on désigne pudiquement la silicose) doit être bien payé et
avoir 70% de la CNSS. Or
il cesse ses activités aux charbonnages et il est inapte à reprendre un travail
ailleurs. Tant qu’il est en activité, il est soigné lui-même et sa famille.
Mais quand il part, il n’a p)lus droit ni aux soins ni à une activité
quelconque .
Des hommes minés par la
silicose
Généralement, les gens de Jérada
même, mieux avertis par l’expérience et les années, préfèrent travailler de
jour en surface, plutôt que dans la nuit éternelle du fond, de crainte
d’attraper la silicose. Ce qui n’est pas le cas des paysans déracinés venu de
loin qui, pour gagner leur vie, n’hésitaient pas à aller au hassi (puits), soit parce qu’ils ignoraient le risque encouru pour leur santé, soit
parce qu’ils étaient attachés par un meilleurs gain, car le travail du fond est
mieux rémunéré que celui de surface. Hélas, ils ne comprenaient ce qui leur
arrivait qu’une fois atteints dans leur chair : « J’ai fais un
arrêt de maladie à cause de la silicose ». nous confie ce mineur d’une
quarantaine d’année qui travailla dans la force de l’âge(de 1977 à 1982) au
puits F3 : « Depuis lors, je n’ai plus travaillé et je suis
toujours malade. Je n’ai pas de quoi me soigner. La mine ne vous prend en
charge qu’une année après l’arrêt du travail. Après quoi, si vous êtes en bonne
santé, il faut reprendre le travail, sinon rien ».
Il semble qu’on ait préféré
sacrifier « le social » sur l’autel des sacro-saints équilibres
financiers.Mais le coût social de la fermeture se révèle d’ores et déjà plus
lourd puisque rien n’a été prévu pour redonner du travail et de l’espoir.
Son identité est celle de son numéro de
matricule « 59913 », son nom véritable, Lahcen Belaïd, il le met entre
parenthèses. L’indemnité de départ permet à peine au mineur de subvenir à ses
besoins vitaux pendant trois à quatre ans. Mais passé ce délai, il se retrouve
avec une rente trimestrielle qui varie de 500 à 700 DH, et parfois 70 DH !
Le plus grave est l’inaptitude physique qui se répercute sur toute la famille.
Actuellement à Jérada, il y a des veuves qui ont deux à sept enfants à charge.
Leur père est décédé à cause de la silicose, souvent précocement, bien avant
l’âge de la retraite. Qui va s’occuper des enfants et de leur avenir ?
Jérada, isolée, se voit impuissante face au drame silencieux qui la mine. Sans
perspective, elle constitue une véritable bombe à retardement sur le plan
social. Villes aux ruines visibles et invisibles, peuplée désormais de fantômes
errants, Jérada serait-elle la nouvelle Atlantide ? Défunte est la raison
d’être d’une ville de près de 70 000 habitants, qui continuent pourtant
d’exister même si elle n’est plus que l’ombre d’elle – même. Une ex-ville
minière en sursis, où on a pourtant érigé récemment d’imposantes bâtisses
administratives (celles de la municipalité et de la province), arborant marbre
et pierre de taille, au milieu des taudis, comme pour indiquer que la ville
devrait survivre à sa raison d’être. Mais de quoi va-t-elle vivre, une fois que
le dernier puits sera fermé en juin 2001 ? Mystère. En attendant pour
survivre, les fils des derniers mineurs bricolent, creusent de nouveaux puits
de façon informelle au péril de leur vie. Travail au noir, travail dans le
noir…C’est dire à quel point pour préserver leur travail et leur dignité, les
gens de Jérada, préfèrent de loin prendre tous les risques, y compris pour leur
vie et leur santé. Maintenant que Jérada n’a plus de mine de charbon, il lui
faut beaucoup d’imagination pour s’ensortir.
Polyvalence ou inertie
Avec la fermeture du dernier
puits en 2001, le troisième millénaire semble mal engagé pour les mineurs de
Jérada et surtout pour leurs enfants. Une fois les indemnités dépensées, de
quoi vivront les mineurs et leurs familles ? On évoque la possibilité de
développer une industrie textile, d’exploiter l’alfa qui recouvre les immenses
étendues alentour, d’un possible retour à la terre : pour le moment de
simples idées de projets échafaudés sans réalisations concrètes. Une chose est
sûre, aucune reconversion n’a été planifiée dans la perspective de la
fermeture. Le sentiment qui prédomine est que le protocole d’accord qui y
a conduit a été signé à la hâte et qu’il aurait fallu maintenir la mine en
exploitation encore quelques années -elle est exploitable encore pour un siècle
nous dit-on- le temps de préparer une reconversion économique fondée
principalement sur le potentiel humains, surtout jeune, dont regorge Jérada.
Mais il semble qu’on ait préféré sacrifier le « social » sur l’autel
des sacro-saints équilibres économiques : maintenir une mine dont le
charbon n’est plus compétitif supposerait de coûteuses subventions. Mais le
coût social de la fermeture se révèle d’ores et déjà plus lourd puis que rien
n’a été prévu pour redonner du travail et de l’espoir.
Une part des indemnités
sert à l’émigration
clandestine
Certaines familles vivent ici
depuis le lancement de la mine en 1936, c’est-à-dire depuis plusieurs
générations. Difficile pour elles de se couper de leurs racines pour aller
trouver logis et travail ailleurs. Par conséquent, nombre de ces familles sont
condamnées à rester sur place avec le sentiments que la charrue a été mise
avant les bœufs : il aurait fallu préparer longtemps à l’avance la
reconversion économique, au lieu d’y être acculer dans l’urgence une fois la
mine fermée. Car le passage d’une économie à une autre prend du temps, beaucoup
de temps, parce qu’il nécessite, outre des investisseurs et des investissements
financiers, la formation des hommes et leur préparation aux nouveaux rôles
qu’ils seront amenés à jouer dans une économie où la mine n’existe plus. Une
mutation de toute une économie régionale, prenant en compte à long terme des
complémentarités avec l’Algérie voisine, ce qui relève beaucoup plus de la
décision politique et de la stratégie économique au niveau gouvernemental, que
du bricolage au niveau des individus auquel on assiste actuellement. En
l’absence de vision claire chez les élus, chacun s’en sort comme il peut. Pour
le moment, en lieu et place de la mine, les derniers mineurs n’ont plus pour survivre
que le bricolage dans le cadre d’une économie informelle. Le potentiel humain
reste le principal atout sur lequel peut se fonder une éventuelle reconversion
de l’économie locale. Un potentiel humain fondé sur la polyvalence et la
capacité d’adaptation dont font preuve certains jeunes diplômés. C’est le cas
par exemple d’Ahmed Issiali, ce fils de mineur, titulaire d’un doctorat en
chimie, qui s’est convertit à la distribution de produits pharmaceutiques tout
en créant une entreprise de plastique avec un autre jeune associé. Une attitude
novatrice qui dénote avec la mentalité des parents pour lesquels, il n’y a pas
d’autre salut que la mine : l’absence de polyvalence conduit à la même
inertie que la
silicose.
Abdelkader Mana
[i] Enquête parue au bimensuel Medina,
de Mars -Avril2001.


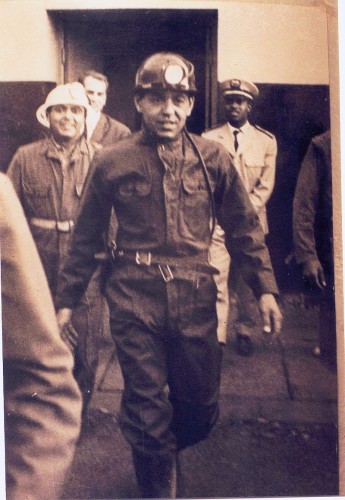





Aucun commentaire